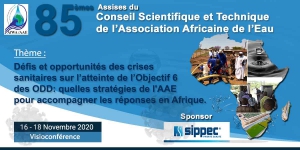Nzickonan Stéphanie
GWOPA / Appel à propositions ouvert : Le Programme EU-WOP lance un appel à propositions pour des partenariats de services publics dans le but de faire avancer les progrès de l'ODD 6
Bonn, Allemagne, 15 janvier 2021 - Le programme EU-WOP a lancé un appel à propositions pour des partenariats de soutien mutuels à but non lucratif. Il s'agit de la première étape d'un programme de quatre ans, financé par l'Union Européenne, et mis en œuvre par la GWOPA UN-Habitat, visant à soutenir les services d'eau et d'assainissement par le biais des WOP (Partenariat des Opérateurs de l'Eau en Anglais). Au niveau mondial, 2,1 milliards de personnes sont toujours privées d'eau non contaminée et disponible quand elles en ont besoin. Les données relatives à l'assainissement sont encore plus alarmantes avec 4,5 milliards de personnes manquant toujours de services sûrs qui les protègent des maladies. La crise du COVID-19 a mis en évidence l'importance vitale des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement.
La COVID 19 au cœur des débats de la 27ème réunion ordinaire du Conseil National des Ressources en Eau du Nigeria Ressources en Eau du Nigeria
La 27ème réunion ordinaire du Conseil national des ressources en eau a eu pour thème "La gestion des ressources en eau en crise" : L'expérience nigériane", qui a débuté le lundi 30 novembre 2020, s'est achevée avec succès le vendredi 4 décembre 2020. De nombreuses personnes y ont assisté malgré la pandémie COVID 19. Le Conseil était un rassemblement de décideurs politiques, d'experts techniques, de partenaires de développement et de l'Association africaine de l'eau (AAE) - l'Association nigériane pour l'approvisionnement en eau (NWSA), personne focale pour le Nigeria.
L'objectif de la réunion était d'apporter des solutions aux défis auxquels est confronté le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (WASH), d'aborder le facteur du changement climatique et de solliciter un engagement plus important des acteurs du secteur. La réunion du conseil s'est focalisée sur les défis de l'eau rencontrés par le secteur nigérian de l'eau avant et après la pandémie COVID 19 et sur l'impact du changement climatique sur la gestion intégrée des ressources en eau.
Le conseil s'est ouvert par une session technique plénière au cours de laquelle des questions essentielles de la précédente réunion du conseil ont été soulevées sur l'examen des notes d'action adoptées. Il a été noté que, bien que la COVID-19 ait été accompagnée de nombreux défis, elle a néanmoins engendré un professionnalisme et un esprit de collaboration dans la réponse sectorielle pour combattre les problèmes communs et favoriser la coordination entre les entreprises, lorsque cela est possible.
La réunion a souligné l'importance des services WASH gérés en toute sécurité pour la prévention et la protection de la santé humaine lors des épidémies de maladies infectieuses, y compris l'actuelle pandémie de COVID-19. L'accent a été mis sur l'investissement dans les infrastructures de santé publique de base, y compris les systèmes d'eau et d'assainissement. Cela a également été considéré comme essentiel pendant la phase de rétablissement d'une épidémie afin d'atténuer les impacts secondaires sur les moyens de subsistance et le bien-être des communautés.
Le point focal de l'AAE-NWSA, M. Francis Umemezia a mis en évidence les défis auxquels est confronté le secteur de l'assainissement en s'appuyant sur sa précieuse expérience acquise en travaillant avec l'AAE au Nigeria. Tout en contribuant à la nécessité d'harmoniser et de contrôler les activités d'assainissement urbain, il a fait remarquer que l'une des raisons pour lesquelles l'assainissement, en particulier la gestion des boues de vidange, a été tant négligé est le manque bonne gouvernance institutionnelle et domestique. Il a noté que l'effort de l'AAE pour identifier les opérateurs d'assainissement critiques dans les États révèle que les rôles ne sont pas correctement rationalisés car les divers États ont des dispositions diverses, alors que certains n'ont pas de dispositions définies.
Le forum a donné l'occasion au point focal de l'AAE-NWSA d'informer le Conseil lors de la séance plénière technique, et le Comité des directeurs généraux des agences de l'eau lors d'une réunion spécialement prévue avec la NWSA, que l'AAE a désigné six municipalités dans six États, à savoir les États de Enugu, Lagos, Delta, FCT, Ogun et Niger au Nigeria, pour bénéficier du Citywide Inclusive Sanitation (CWIS) et deux services publics d'État, le FCT Water Board et la Taraba State Water and Sanitation Corporation, pour bénéficier du programme d'amélioration de la qualité de l'eau. Les agences de l'eau et les opérateurs ont donc profité de cette occasion pour s'enquérir des stratégies visant à améliorer les performances et à renforcer les relations avec l'AAE.
Malgré les efforts déployés par l'Association Africaine de l’Eau pour renforcer la collaboration avec les services publics membres de l'Association nigériane de distribution d'eau afin d'améliorer leurs performances, il a été constaté qu'un très petit nombre de services publics avaient adhéré à l’Association. Il a donc demandé au Conseil d'apporter un soutien aux compagnies du Nigeria pour leur permettre d’être membre de l’AAE afin de bénéficier de son solide programme de renforcement des capacités et de coopération entre pairs et d'encourager les États à coopérer dans ce domaine. Cela fait partie de l'effort stratégique visant à améliorer l'enregistrement des services publics et à surmonter les goulets d'étranglement bureaucratiques pour obtenir les autorisations annuelles.
Rev. (Engr.) Francis UMEMEZIA
(Point focal AAE-NWSA)
PSI CI en synergie d’actions avec la Direction de l’Assainissement en milieu Rural (DAR)
Selon les résultats de l’enquête à indicateurs multiples (MICS) initié par le Ministère du Plan en 2016, le taux de défécation à l’air libre au niveau national était globalement autour de 22%. En milieu urbain, il avoisine 3% et malheureusement 39% en milieu rural. http://www.ins.ci/n/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=66 (source)
Pour contenir ces pratiques peu louables, le Ministère de la Salubrité et de l’Assainissement (MINASS) à travers son Département de la Direction de l’Assainissement en milieu Rural (DAR), a participé à la formation des agents recrutés pour assister les populations à faible revenu dans leur désir d’accéder à des services d’assainissement adéquats en milieu péri-urbain et rural. Cette initiative financée par USAID permettra au gouvernement ivoirien de relever le défi suivant consigné dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) alinéa 6.2 : « Assurer d’ici à 2030 l’accès de tous, dans les conditions équitables à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation vulnérable ». Cet atelier de formation a également servi de cadre pour renforcer la collaboration entre la DAR et la PSI-CI.
Il importe de signifier qu’un Manuel Technique de réalisation des ouvrages d’assainissement a été élaboré et validé au cours de ces échanges, pour assurer une meilleure gestion des connaissances des techniciens engagés dans ce processus. Il demeurera un guide pratique de référence pour les Très Petites Entreprises (TPE) qui souhaiteraient réaliser et/ou construire des ouvrages d’assainissement de qualité.
Concernant la problématique de défécation à l’air libre, un autre atelier de renforcement des capacités a été organisé à l’endroit des agents communautaires constitués en très petites entreprises (TPE) dans le mois de Décembre 2020 à Yamoussoukro. Il a permis de former et encadrer les ménages choisis à la construction des latrines familiales améliorées en collaboration avec PSI-CI.
A la suite de ces orientations en salle, une phase pratique a été initiée pendant laquelle les TPE ont pu assister à la mise en place d’une toilette dans le village de Akpéssekro, situé à quelques kilomètres de la ville de Yamoussoukro. Cette pose faite en présence du Chef dudit village, de la DAR et des techniciens du Projet SSD de PSI CI servira à des heureux bénéficiaires pendant de longues années.
Selon Madame BRAGORI Hélène Epouse YOKOLLY, Directrice de l’Assainissement en milieu Urbain (DAR) présente à cette activité ; « Ce partenariat avec PSI CI nous permettra d’accélérer l’accès et l’amélioration de l’assainissement en Côte d’Ivoire. Aussi, j’ai bon espoir que cette formation offerte à nos TPE favorisera l’éclosion d’activités pour un meilleur assainissement du cadre de vie de nos populations surtout ceux des milieux ruraux ».
Notons qu’à la suite de cette collaboration, les activités à venir sont les constructions des toilettes SaniPlus avec son système de lavage des mains au niveau des écoles en milieux urbain.
Améliorer les besoins en eau, en assainissement et en hygiène : Huit municipalités de Côte d’Ivoire sélectionnées pour participer au projet MuniWASH financé par USAID
Améliorer les besoins en eau, en assainissement et en hygiène : Huit municipalités de Côte d’Ivoire sélectionnées pour participer au projet MuniWASH financé par USAID
C'est officiel, huit communes de Côte d'Ivoire ont été informées de leur sélection pour participer au projet Eau, Assainissement et Hygiène en Afrique de l'Ouest (MuniWASH). Le projet MuniWASH est financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Ce projet est mis en œuvre par Tetra Tech, au Bénin et en Côte d'Ivoire, pour une période de cinq ans (2019-2024). L’objectif de MuniWASH est d’aider les municipalités, les agences et directions nationales, les services publics et prestataires de services privés du Bénin, de la Côte d’Ivoire et potentiellement d’autres pays de l’Afrique à consolider et développer les services d’eau, d’assainissement et de l'hygiène à l’échelle de la ville afin de répondre aux besoins critiques, intégrant les populations pauvres et mal-desservies des municipalités ciblées.
Cette annonce est le résultat d'un processus de sélection impliquant la participation de plusieurs organismes publics et privés tels que la Direction Générale de l'Administration Territoriale, l'Office National de l'Eau Potable, l'Office National de l'Assainissement et du Drainage, la Direction de l'Hydraulique, la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire, et enfin l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les huit communes sont Abengourou, Abobo, Bouaké, Gagnoa, San Pedro et Soubré, Yamoussoukro et Yopougon. Certaines de ces communes sont également des zones d'intervention pour le projet de Prestation de Services d'Assainissement (SSD) financé par l'USAID pour la période de mise en œuvre 2014-2021. Les projets comportent de nombreuses activités complémentaires et ils partageront les leçons apprises pour un succès mutuel. MuniWASH soutiendra et étendra les réalisations du projet SSD comme l'a souligné le directeur du projet MuniWASH, Safaa Fakorede : "MuniWASH fera appel aux entrepreneurs en assainissement formés par SSD au Bénin et en Côte d'Ivoire pour leur permettre d'intensifier leurs activités, notamment par la mobilisation de capitaux".
.
En septembre 2020, l'équipe du projet MuniWASH a rencontré les conseils municipaux dans chacune des communes cibles. Cette réunion de notification officielle de la sélection finale des municipalités a été l'occasion de présenter le projet MuniWASH aux différents acteurs. Il s'agissait notamment des maires, des membres des conseils municipaux, des secrétaires généraux, des chefs des services techniques des communes, de certains directeurs régionaux des ministères chargés de l'eau et de l'assainissement ainsi que des opérateurs du secteur privé exerçant au niveau local.
L'équipe de mise en œuvre de MuniWASH a profité de cette tournée pour présenter également le projet aux autorités régionales, y compris les préfets. Le secrétaire général de la préfecture de Gagnoa s'est félicité de la mise en œuvre de ce projet axé sur le renforcement des capacités. "Le meilleur investissement est celui qui est fait sur les hommes, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Plus de 80% des fonctionnaires municipaux sélectionnés ne connaissent pas suffisamment les tâches qui leur sont assignées. Il faut donc les former", a-t-il dit.
Au cours des échanges, il a été noté qu'il y a une très forte attente de la part des communes en matière de financement des infrastructures. ‘‘Nous avons pensé que le projet allait financer directement les infrastructures", a expliqué Koulaï Marius, directeur technique de la mairie de Gagnoa en Côte d'Ivoire. Au cours de cette tournée, l’équipe MuniWASH a expliqué que le rôle du projet n’était pas de fournir un financement direct des infrastructures, mais d’améliorer globalement l’environnement d’investissement pour un accroissement de la viabilité financières et des investissement du secteur privé pour les services publiques et les fournisseurs d’accès. Pour le secrétaire général de la commune de Soubré, M. Lacina N'DA Jean, il est nécessaire de "soutenir le renforcement des capacités en accordant un financement direct aux communes".
MuniWASH place l'amélioration de la gestion et de la gouvernance municipales dans les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène au centre de ses actions. Avec l'appui du Ministère de l'Administration Territoriale à travers la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, le projet MuniWASH renforcera les capacités des communes pour une meilleure gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau municipal.
En outre, le projet MuniWASH compte améliorer la viabilité financière et les investissements du secteur privé pour les services d’Eau potable, d’Assainissement et d'Hygiène et à améliorer la fiabilité opérationnelle des services publics et privées. Le projet permettra de partager les expériences réussies et les enseignements tirés de la mise en œuvre de ses activités, ainsi que de diffuser les bonnes pratiques aux niveaux national et régional, principalement par l'intermédiaire de l'Association Africaine de l'Eau (AAE). Cela permettra aux communes non-sélectionnées pour le programme de bénéficier des connaissances acquises lors de la mise en œuvre du projet MuniWASH.
Huit municipalités du Bénin sélectionnées pour participer au projet MuniWASH financé par USAID
Améliorer les besoins en eau, en assainissement et en hygiène : Huit municipalités du Bénin sélectionnées pour participer au projet MuniWASH financé par USAID
C'est officiel, huit communes du Bénin participeront au projet Eau, Assainissement et Hygiène en Afrique de l'Ouest (MuniWASH) financé par l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Le projet MuniWASH est un projet régional financé par USAID et mis en œuvre par Tetra Tech, au Bénin et en Côte d'Ivoire pour une période de cinq ans (2019-2024). L’objectif de MuniWASH est d’aider les municipalités, les agences et directions nationales, les services publics et prestataires de services privés du Bénin, de la Côte d’Ivoire et potentiellement d’autres pays de l’Afrique à consolider et développer les services d’eau, d’assainissement et de l'hygiène à l’échelle de la ville afin de répondre aux besoins critiques, intégrant les populations pauvres et mal-desservies des municipalités ciblées.
Cette annonce est le résultat d'un processus de sélection qui a impliqué le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, le ministère de l'eau et des mines, le ministre de la santé, le ministère du cadre de vie et du développement durable, la société nationale des eaux du Bénin, l’association nationale de communes du bénin, le partenariat national pour l’eau, la commission nationale des finances locale et l'association béninoise de marketing social et de communication pour la santé, entre autres. Il s'agit des communes d'Abomey-Calavi, d’Allada, d'Aplahoué, d’Avrankou, de Bohicon, de Cotonou, de Ouidah et de So-Ava, dont certaines sont des zones d’intervention du projet de Prestation de services d'assainissement (SSD), également financé par l'USAID pour la période de mise en œuvre 2014-2021. Les projets comportent de nombreuses activités complémentaires et ils partageront les leçons apprises pour un succès mutuel.
En septembre 2020, l'équipe du MuniWASH a rencontré les conseils municipaux de chacune des communes cibles. Ces réunions de notification officielle ont été l'occasion de présenter le projet MuniWASH aux différents acteurs impliqués. Il s'agissait des maires, des membres des conseils municipaux, de responsables techniques de l'administration municipale, de services déconcentrés de l'État ainsi que d'opérateurs du secteur privé opérant au niveau municipal. Dans la commune d'Aplahoué, par exemple, la Société Nationale des Eaux du Benin (SONEB), un service de l'eau du Bénin, a participé à la réunion.
Au cours des échanges, il est ressorti une volonté très affichée des communes de s'engager avec MuniWASH. "Ce projet est le bienvenu, nous sommes prêts à signer un protocole d’accord avec MuniWASH", a déclaré Ahouandjinou Randyx, premier adjoint au maire de Cotonou, la capitale économique du Bénin.
L'accès aux services d'eau potable reste un défi au Bénin, malgré une une amélioration significative au cours de la dernière décennie. Selon le rapport 2019 de la SONEB, d’accès à l’eau en milieu urbain est désormais de 62%. Le maire de la commune d'Avrankou, M. Ganhoutode Sèna Gabriel, fait remarquer des efforts supplémentaires doivent encore être faits: "le problème de l'eau potable est aigu. Nos zones périurbaines souffrent beaucoup du manque d'accès à l'eau potable. Notre souhait est de voir MuniWASH mener des actions concrètes ayant un impact direct sur les populations en leur permettant d'avoir un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement", a-t-il déclaré.
Pour leur part, les membres du conseil municipal de chacune des huit municipalités se sont réunis en séances de délibération et ont donné leur accord pour autoriser le maire à signer le protocole d'accord entre MuniWASH et la municipalité pour la mise en œuvre du programme.
MuniWASH se concentre sur le renforcement des capacités opérationnelles, financières et techniques des communes pour une meilleure gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau municipal. "Le volet de renforcement des capacités aidera les cadres des mairies à améliorer leurs performances", a poursuivi M. Gabriel.
En outre, le projet compte améliorer la durabilité financière et les investissements du secteur privé en faveur des prestataires de service d’Eau, d’Assainissement et de l'Hygiène et la fiabilité opérationnelle des services publics et fournisseurs de services WASH. Comme l'explique M. Gabriel, de nombreux participants ont salué le fait que "MuniWASH s'efforcera de mobiliser des ressources pour le financement d'infrastructures afin d'améliorer les conditions des ménages pauvres et mal desservis". En définitive, MuniWASH collabore avec l’Association Africaine de l’Eau (AAE), spécialisée en apprentissage, pour partager les bonnes pratiques au niveau national et régional et orienter les interventions en Eau, Hygiène et Assainissement en milieu urbain.
Cela permettra aux communes non sélectionnées pour le programme de bénéficier des connaissances acquises lors de la mise en œuvre de MuniWASH.
Réalisation de l’ODD6 : les experts de l’AAE présentent les stratégies pour accompagner les réponses en Afrique
«Nous savons tous qu'au cours des derniers mois, le monde a connu un très grand changement. Et nous parlons tous de la nouvelle normalité. En tant que membres de l'AAE, nous avons continué à rester en contact et à faire notre travail pendant les périodes difficiles, et je crois que nous avons fait de grands progrès ». C’est en ces termes empreints de fierté que Dr Rose Kaggwa, 2ème présidente du Conseil Scientifique et Technique de l’Association Africaine de l’Eau s’est adressée aux participants des 85ème assises du CST qui se tenaient du 16 au 18 novembre 2020 sous le thème est « Défis et opportunité des crises sanitaires sur l’atteinte de l’Objectif 6 de Développement Durable (ODD 6) : Quelles stratégies de l’AAE pour accompagner les réponses en Afrique». La deuxième présidente exprimait par-là sa satisfaction pour la résilience dont ont fait preuve les membres de l’AAE durant la crise sanitaire puisqu’en dépit des restrictions de déplacement, les rencontres de l’association se sont poursuivies en mode virtuel.
Dr Kaggwa a expliqué que la COVID 19 a accru les besoins en eau et confirmé combien il était important de disposer de la ressource pour lutter contre la maladie. Elle s’est réjouie du fait que dans la plupart des pays, des installations de lavage de main ont pu être mises à disposition y compris des populations se trouvant hors des réseaux de distribution. C’est pourquoi elle a plaidé pour que dans le cadre de l’atteinte des ODD, « ces installations soient transformées en raccordement domestiques réels ».
Le président du CST, Dr Papa Samba a pour sa part tiré la sonnette d’alarme : « La COVID-19 risque d’anéantir des décennies de progrès » et évoquant le thème du CST, il a rappelé qu’en dépit de la crise sanitaire qui a freiné l’élan de l’humanité tout entière, « nous avons des objectifs à atteindre, parce que cette crise ne fait pas disparaître les défis que nous avons en matière d’accès des populations d’Afrique aux services d’assainissement et à l’eau. L’Afrique où 320 millions de personnes n'ont toujours pas accès à de l'eau potable répondant aux normes d'hygiène de base et 695 millions de personnes en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à des services d’assainissement adéquats ». Il a invité ses pairs à s’inscrire résolument dans la marche vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.
La cérémonie d’ouverture du CST a débuté avec la minute de silence observée à la mémoire de M Zady Kessi Marcel, père fondateur de l’AAE, rappelée à Dieu le 13 octobre 2020 et s’est poursuivie avec la conférence des industriels qui ont proposé des technologies innovantes pour accélérer l’accès à l’eau et aux services d’assainissement sur le continent.
Le 2ème jour a été consacré à la réflexion sur la réorganisation du CST notamment la mise en place de groupes spécialisés et a été présentée par le Président du CST, Dr Papa Samba DIOP .
Le dernier jour des travaux a porté essentiellement sur l’«Etat d'avancement des préparatifs du 21ème Congrès CONAKRY 2022» avant que ne soient organisés deux ateliers portant sur (1) les « Effets de l’Eau Non-Facturée sur la gestion technique et financière des sociétés d’eau : Cas du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ; (2) les « Besoins requis en termes de renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre d'un projet d’assainissement inclusif à l’échelle de la ville en Côte d'Ivoire et au Ghana ».
Enfin, il a été également longuement question d’un questionnaire destiné aux membres, sous la forme d’une enquête de satisfaction qu’un cabinet recruté pour le besoin, va administrer dans les prochains jours à tous les membres de l’AAE.
Les 86èmes assises du Conseil Scientifique et Technique de l’AAE auront lieu au mois de février 2021.
Burkina Faso : quand le barrage de Ziga met fin à la corvée de l’eau à Ouagadougou
L’accès à l’eau au plus grand nombre est depuis des décennies un des volets du projet social de l’Etat burkinabé. En dépit de nombreuses actions menées, les difficultés d’approvisionnement en eau sont persistantes dans le pays. Elles viennent de deux facteurs contextuels aggravants qui sont la rareté naturelle de l’eau et la croissance urbaine induisant une pression de plus en plus grande sur la ressource disponible et sur les infrastructures existantes. Ouagadougou présente des conditions climatiques et géographiques qui induisent une pénurie d’eau quasi endémique avec un risque permanent de sécheresse. Le réseau hydrographique naturel est très limité. Il se compose d’un unique talweg, le Boulmigou, qui traverse la ville d’est en ouest, auquel est reliée une série de marigots très temporaires, du fait des conditions climatiques. La ville appartient au domaine climatique nord soudanien caractérisé par des amplitudes thermiques annuelles relativement élevées et une pluviométrie très irrégulière. Les précipitations sont importantes en juillet-août au niveau de leur volume et en mai et septembre au niveau de leur force. Une grande partie des précipitations est renvoyée dans l’atmosphère par l’évapotranspiration, réduisant ainsi la quantité de pluie effectivement infiltrée dans le sous-sol. Cette infiltration est en plus compromise par l’imperméabilisation des surfaces urbanisées qui favorisent le ruissellement.
Offrir de l’eau à la population
Pour répondre à l’accroissement continu des besoins en eau, le barrage de Loumbila, situé à 20 kilomètres de la capitale, a été construit en 1970. Par la suite, le déficit pluviométrique de 1983 ayant entraîné le remplissage très partiel des barrages, un programme de développement d’ouvrages de captage exploitant les ressources souterraines a été mis en place, notamment dans les quartiers périphériques de la ville, par la construction de forages mécaniques ou de pompes manuelles. Les forages ne constituent cependant qu’une solution de complément à court terme du fait de l’inexistence de nappes aquifères continues et de grande capacité. En 2006, l’Etat entreprend la construction du barrage de Ziga sur le Nankamba, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville, pour servir de 3ème source d’approvisionnement. Ce barrage doit assurer la durabilité de l’approvisionnement en eau de la capitale.
100% de la population de la capitale dispose de l’eau
D’une capacité de 207,8 millions de m3 d’eau et un bassin versant d’environ 20 800 km2, le barrage de Ziga a été mis en eau en 2000. Il alimente une station éponyme de 12 000 m3 par heure et comporte deux stations d’eau brute (SP1 et SP1 bis), une station de traitement et deux stations de refoulement eau potable (SP2 et SP2 bis). Le barrage permet de produire 12 000 m3 par heure pour les besoins d’environ 2 400 000 et 1 210 Bornes fontaines dans la capitale Burkinabé et environs. Ainsi, le barrage de Ziga à lui seul suffit à couvrir les besoins de la population de la capitale Burkinabé estimée à environ 2 800 000 habitants. La distribution d’eau intermittente dans la capitale n’est plus qu’un lointain souvenir pour les habitants.
Des menaces sur la qualité de l’eau
Les populations riveraines du barrage pratiquent le maraîchage sur les rives et avancent dans le lit du barrage au fur et à mesure que l’eau se retire. Pour lutter contre les insectes et les animaux nuisibles (vers, rats, rats-voleurs, lièvres, perdrix, pintades sauvages, …) qui détruisent leurs légumes, ils emploient des pesticides de synthèse, dont beaucoup sont interdits d’usage. Des fertilisants sont également utilisés. Ce qui constituent une grave menace sur la qualité de l’eau et par ricochet sur la vie des populations. Un autre élément qui menace la qualité de l’eau produite par le barrage de Ziga vient de la nature: les algues, dont le développement est causé par les déjections animales et engrais chimiques. En plus de menacer la qualité et la pérennité de l’eau, ces algues renchérissent le coût de production de celle-ci. En effet, ces végétaux produisent des substances qui donnent à l’eau des odeurs de pourriture et de fosses septiques ainsi que des flaveurs de moisissure mettant en danger la caractéristique potable de l’eau.
Solution naturelle et innovante
Au regard de l’impact négatif des algues sur la qualité de l’eau, le laboratoire environnemental et social de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) du Burkina Faso a développé depuis 2010 des solutions alternatives à l’utilisation abusive des produits chimiques. Ainsi, pour venir à bout de ces algues toxiques l’ONEA a introduit dans les eaux du barrage, des poissons planctophages : les tilapias (pour qui ces algues toxiques constituent un aliment principal). En effet, 4,5 millions de tilapias de 50 grammes ont été introduits pour l’épuration des 208 millions de m3 d’eau de Ziga. En termes d’avantages, cette solution permet à l’ONEA de baisser la quantité de produits chimiques utilisés et continuer à servir une eau de qualité. Au bout de 3 ans, les populations sont autorisées à pêcher ces poissons, (non toxiques pour l’homme), ce qui permet d’injecter 315 millions de FCFA dans l’économie.
Mesures de protection
L’ONEA a pris des mesures strictes pour protéger l’eau du barrage des autres sources de pollution. Ainsi, une zone de servitude ou périmètre de protection a été défini autour du barrage pour éviter certains actes de pollution posés par l’homme et l’endommagement des installations de captages. Pour ce faire, Il est formellement interdit de pêcher, en dehors des périodes prévues pour la pêche des tilapias), d’abreuver les animaux et de faire du maraîchage sur les berges, en amont du barrage. La pêche ordinaire n’est autorisée qu’à l’aval. Enfin, afin de lutter contre l’envasement et l’évaporation de l’eau du Barrage, l’ONEA, procède au reboisement progressif de la zone de servitude du Barrage de Ziga.
Un contrôle qualité régulier
À l’instar de toutes les eaux produites au Burkina par l’ONEA, les Eaux du barrage de Ziga sont soumises au contrôle de conformité universelle, notamment les normes (recommandations de l’OMS) en vigueur, pour les paramètres physico-chimiques, organo-leptiques et microbiologiques. Ce contrôle se fait en plusieurs phases: D’abord le suivi à pied d’œuvre, par les agents de production d’eau toutes les deux heures ; ensuite le contrôle interne du Laboratoire Central de l’ONEA au moins une fois par mois, avec capacité de recherche des micropolluants (métaux lourds et pesticides); enfin le contrôle externe du Laboratoire National de Santé public.
Du barrage au robinet
Le barrage de Ziga a été réalisé grâce au financement de 12 bailleurs de fonds et a coûté environ 150 milliards de FCFA pour la phase I, et 107 milliards de FCFA pour la phase II. Sa mise en œuvre vient assurer l’accès universel des populations de Ouagadougou à l’eau potable, mais aussi améliorer la qualité de la desserte en assurant la continuité du service 24h/24, y compris en saison chaude et dans tous les quartiers de la ville capitale. Avec ce projet « barrage de Ziga» l’on peut dire que, l’objectif du Président du Faso, son Excellence Roch Marc Christian KABORÉ, qui s’est engagé à éradiquer la corvée d’eau d’ici 2020, s’est réalisé pour la ville de Ouagadougou. Notons enfin que pour ce qui est de l’accès à l’eau au Burkina Faso, relativement à l’Objectif 6 de Développement Durable, des progrès ont été enregistrés en 2017 avec un taux d’accès à l’eau potable de 66,2% en milieu rural et 91,7% en milieu urbain.
Il convient de sensibiliser la population à se raccorder à un ouvrage d’assainissement durable et décent et de se munir d'un dispositif adéquat de lavage des mains.
Avant tout développement dans le fond, j’adresse mes remerciements à M. Sylvain Usher, directeur exécutif pour m’avoir donnée l’opportunité de m’exprimer, en ma qualité de présidente du REDFEPEA à l’occasion de la journée mondiale des Toilettes célébrée le 19 novembre dont le thème cette année porte sur «l’assainissement durable et le changement climatique ».
En effet, ces derniers temps, le changement climatique impacte considérablement la République de Djibouti notamment avec la survenance des inondations fréquentes et intenses qui ont causé des catastrophes majeures.
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de l’Eau et de la Pêche chargé des ressources
halieutiques en collaboration avec l’ONEAD et le REDFEPEA , le réseau djiboutien des
femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement célébreront cette journée mondiale
des toilettes en organisant des activités diverses .
En premier lieu, il convient de sensibiliser la population à se raccorder à un ouvrage d’assainissement durable et décent et de se munir d'un dispositif adéquat de lavage des mains.
Cette sensibilisation au regard de l’intérêt que revêt le lavage des mains pour la sureté des ménages, annihilera conséquemment les maladies liées au manque d’hygiène et favorisera ainsi, à long terme, l’espérance de vie de ces ménages.
En cela, comme la jeunesse est le meilleur vecteur de sensibilisation, nous faisons des établissements scolaires une priorité dans nos actions de sensibilisation surtout en ce temps de
pandémie COVID19, il est important de rappeler les gestes essentiels.
Mariam AHMED, Présidente du réseau Djiboutien des Femmes Professionelles de l'Eau et de l'Assainissement
Rien de plus stupéfiant que de voir qu’en Afrique, les mêmes personnes n’ayant pas accès à des toilettes se promènent la tête haute dans les communautés avec un smartphone en main…
Rien de plus stupéfiant que de voir qu’en Afrique, les mêmes personnes n’ayant pas accès à des toilettes se promènent la tête haute dans les communautés avec un smartphone en main…
Pourquoi le continent africain peine à relever le défi de l’assainissement? Tout simplement parce que la plupart des pays africains préfèrent investir des milliards dans la construction des routes et des réseaux de télécommunication que dans la construction de réseaux d’assainissements et/ou de toilettes aux normes ! Les pays africains ne comprennent-ils pas que les inondations, les sécheresses et la raréfaction des ressources en eau continueront d’avoir des répercussions sociales, sanitaires et environnementales catastrophiques mais surtout alarmantes pour la planète ?
En Afrique subsaharienne, plus des trois-quarts des populations ne disposent pas de toilettes adéquates et des centaines de millions de personnes pratiquent la défécation à l’air libre (en pleine nature, dans des sacs plastiques…) Elles contribuent inconsciemment à la prolifération de microbes, sources de contamination pour les habitants et cours d’eau avec comme vecteurs potentiels de transmission les insectes et les animaux.
Hélas, tout cela arrive au vu et au su des autorités, mais celles-ci ne sont pas les seuls témoins passifs de cette problématique de l’assainissement. Les médias, les associations, les professionnels du secteur, les consommateurs doivent ensemble faire le plaidoyer de l’assainissement (financements et solutions durables) pour que tous les citoyens africains aient un accès digne et sécurisé à des infrastructures d’assainissement.
Cette journée mondiale des toilettes se tient dans un contexte particulier de pandémie de la COVID 19, qui remet en cause la manière dont les défis de l’eau et de l’assainissement doivent être relevés.
En tant que leaders engagées du secteur de l’eau et de l’assainissement, nous les femmes du REMAFPEA, réitérons notre volonté à accompagner l’AAE dans sa quête de solutions africaines pour un accès durable à l’assainissement des plus vulnérables à savoir les femmes et les enfants.
Konaré Kadiatou Malinké, Présidente du Réseau Malien des Femmes Professionnelles de l'Eau et de l'Asssainissement
Ensemble faisons de nos toilettes des moyens de préservation de la vie
Le phénomène de changement climatique est une réalité en Côte d’Ivoire, comme dans le reste du monde. Même si Le pays semble ne pas encore être sérieusement touché par le phénomène en comparaison avec certains autres, la balance pourrait pencher à tout moment et mettre à mal l’économie du pays.
En effet, la croissance économique du pays repose en partie sur l’utilisation de son stock de ressources naturelles. Or Selon M. Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, ces ressources auraient diminué de 26 % entre 1990 et 2014. Plusieurs phénomènes visibles confirment cette dégradation. Parmi eux figurent la déforestation et l’épuisement des réserves d’eau.
En ce qui concerne principalement, les ressources en eau fortement impactées aussi bien en quantité qu’en qualité, les actions de sauvegarde passent entre autres par la lutte contre toutes les formes de pollution et de façon particulière par une gestion adéquate des système d’assainissement.
Avec plus de 80% de la population ayant recours au système d’assainissement autonome, il revient à chacun individuellement ou de façon collective, à travers nos ménages, entreprises de vidange ou par l’intervention des organismes et institutions de promouvoir :
- la réalisation et l’entretien d’ouvrages d’assainissement adaptés notamment les toilettes, les fosses septiques ;
- un système de collecte et de transport sécurisé ;
-la mise à disposition et le bon fonctionnement d’unités de traitement dédiées.
Avec nos cultivateurs, allons encore plus loin en valorisant le produit de nos toilettes en engrais pour stimuler sans risques l’agriculture, réduire et capturer les émissions de gaz à effet de serre.
En effet, Une étude récente publiée par la Soil Association révèle que La conversion au bio permet de séquestrer dans le sol, en moyenne, entre 400 et 500 kg de carbone, soit environ 1650 kg de CO2, par hectare et par an. Aussi, suffirait-il de séquestrer 200 kg de carbone par hectare et par an dans toutes les terres cultivées pour compenser la totalité des émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, la séquestration de carbone dans le sol apparait comme une clé importante dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ensemble faisons de nos toilettes des moyens de préservation de la vie
Avec nos toilettes préservons nos ressources naturelles et créons de la richesse dans une économie circulaire.

 Français
Français  English
English